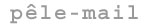|
|
|
+
|
Malcom
Lowry |
|
+
|
les
origines du sacrifice humain chez les Aztèques |
|
|
+
|
nomades |
|
+
|
pêle-mail |
|
| Petite
bibliothèque nomade |
| + |
ANAWALT,
R. Patricia
1986 : "Les sacrifices humains chez les Aztèques", La Recherche,
no 175, volume 17, pp. 322-329 |
| + |
DE
SAHAGUN, F. B.
1981 : Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne,
Paris, Editions François Maspéro. |
| + |
DUVERGER,
Christian
1978 : L'esprit du jeu chez les Aztèques, Paris, Editions Mouton.
1979 : La fleur létale. Economie du sacrifice aztèque,
Paris, Editions Le Seuil. |
| + |
GRAULICH,
Michel
1983 : "Les mythes de la création du soleil au Mexique ancien"
dans L'Ethnographie, no 89-91, pp. 9-31. |
| + |
LE
CLEZIO, J. M. G.
1988 : Le rêve mexicain, Paris,Editions Gallimard.
|
| + |
PETERSON,
F. A.
1961 : Le Mexique précolombien, Paris, Editions Payot.
|
| + |
SIMONI-ABBAT,
M.
1976 : Les Aztèques, Paris,Editions Le Seuil.
|
| + |
SOUSTELLE,
Jacques
1955 : La vie quotidienne des Aztèques, Paris, Editions Hachette |
|
|
 |
Les
origines du sacrifice humain chez les Aztèques
|
|
|
| |
| |
| Introduction
|
|
Dans
sa longue liste des traits culturels définissant
la civilisation mésoaméricaine à
l'époque de la conquête espagnole, l'ethnologue
Paul Kirchoff mentionne les sacrifices humains. Cette
pratique est très ancienne, puisqu'on retrouve
des traces et des indices archéologiques, datant
de 5000 ans avant notre ère, qui témoignent
de la longue histoire du sacrifice humain en Mésoamérique.
Des Olmèques, qui connaissaient le culte de la
tête-trophée, jusqu'aux Mayas, nombre de
civilisations préhispaniques pratiquaient les
sacrifices humains. Mais aucun peuple comme les Aztèques
n'a montré autant de goût pour ces pratiques
sanglantes. Avec eux, le sacrifice humain devient une
institution.
|
|
|
|
| Les
origines du sacrifice humain chez les Aztèques
|
|
Les
Aztèques, jusqu'à aujourd'hui, ont conservé
cette réputation d'un peuple cruel et sanguinaire,
lié à leur pratique intense des sacrifices
humains. Pourtant, à bien considérer les
choses, cette cruauté n'était jamais gratuite,
au contraire de celle des jeux des cirques romains,
mais religieuse, sacrée, voire mystique, toujours
destinée au seul plaisir des dieux. Une clef
fondamentale, pour comprendre les origines des sacrifices
humains aztèques, se trouve dans le mythe le
plus important et le plus répandu de la mythologie
mésoaméricaine : celui de la création
du soleil et de la lune. Dans son Histoire générale
des choses de la Nouvelle-Espagne le chroniqueur espagnol
Bernardino de Sahagun transcrit ce mythe qui raconte
la création, à Tehotihuacan, devant une
assemblée divine, de la première lumière
sur le monde et comment furent choisis le dieu Tecuciztecatl
pour être le soleil et le dieu "bubonneux" Nanuatzin,
pour être la lune. A tour de rôle, sous
le regard des autres dieux, ils doivent se jeter dans
un brasier et raconte la légende "quand le soleil
vint à se lever, il apparut très rouge,
se dandinant d'un côté et d'un autre, et
personne ne pouvait fixer sur lui ses regards parce
qu'il aveuglait. La lune sortit en même temps
que lui également de l'Orient : d'abord le soleil
et la lune à sa suite, dans le même ordre
qu'ils étaient entrés auparavant au foyer."
Malheureusement cette création reste inachevée,
les deux astres restent immobiles dans le ciel. Les
dieux alors désespérés se parlèrent
et dirent :"Comment pourrions-nous vivre ainsi ? Le
soleil ne bouge pas. Est-ce que nous passerons toute
notre existence entre les indignes mortels ? Mourons
tous et faisons que notre mort donne la vie à
ces astres." Après cette discussion, les dieux
consentent à se sacrifier pour déclencher
la course du soleil et de la lune. Immolés l'un
après l'autre, ils nourriront de leurs coeurs
arrachés et de leur sang les deux astres qui
finiront par prendre vie. L'essentiel de cette légende
s'avère être dans la phrase : "Mourons
tous et faisons que notre mort donne la vie à
ces astres." Elle fournit une explication à l'origine
des sacrifices humains chez les Aztèques qui
reprirent la légende à leur compte. Il
fallait renouveler et perpétuer le sacrifice
initial des dieux par celui des hommes. Seul le sang
humain méritait de se substituer au sang divin.
Le sacrifice humain devenait alors légitime et
même nécessaire à la bonne continuation
de l'univers. Afin d'éviter que ce dernier ne
sombre dans les ténèbres, les humains
devaient donc continuer à alimenter l'astre solaire
par l'offrande sans cesse répétée
de leur sang et de leurs coeurs. Pour citer l'ethnologue
Christian Duverger, le sacrifice humain apparaît
comme l'archétype du don : offrande d'un individu
ou d'un groupe d'individus, à la société
toute entière. Quant à ses origines, Duverger
avoue qu'elles restent mystérieuses et qu'il
est vain d'espérer reconstruire - avec les données
actuelles - la genèse exacte du sacrifice humain.
L'ethnologue recense quelques hypothèses d'origine
formulées comme le sacrifice d'animaux, les scarifications
traditionnellement pratiquées à des fins
pénales ou la singulière saignée
de l'agave par mutilation du coeur de la plante, métaphore
frappante du rite sacrifiel. L'histoire généalogique
des sacrifices humains en Mésoamérique
reste donc à faire.
|
|
|
|
| Les
fonctions du sacrifice humain chez les Aztèques
|
|
Comme
nous l'avons déjà introduit, la fonction
principale du sacrifice humain chez les Aztèques
est religieuse : pour apaiser le courroux des dieux
et conjurer le malheur, les hommes doivent nourrir les
forces divines par le sang et le coeur de leurs victimes.
Les hommes sont donc liés aux dieux par ce pacte
de sang substantiel. Ces dieux païens aux yeux
des conquérants espagnols, sont derrière
chaque événement de la vie Aztèque.
Dans une ferveur religieuse quasi mystique, le sang
coule lors de fêtes rituelles complexes, minutieusement
préparées, toutes dévouées
aux nombreuses divinités aztèques. "Pour
honorer le démon, rapporte Sahagun, ils faisaient
ruisseler le sang sur les temples jour et nuit, tuant
hommes et femmes devant les statues des démons
(...) Ils faisaient ruisseler le sang devant les démons
par dévotion, aux jours signalés." Lors
de ces cérémonies chargées de sens
mais incompréhensibles pour les chroniqueurs
espagnols, où se mêlaient le son des tambours,
l'odeur des bûchers sacrés, de l'encens
et du sang répandu, l'individu sacrifié
devait correspondre à l'image du dieu honoré.
Ainsi les Aztèques, dans une riche et magique
mise en scène, transformait le simple mortel
en image divine. Les dieux vénérés,
devenaient alors, par cette matérialisation,
accessibles et finissaient par s'unir aux hommes, chantant
et dansant avec eux. Pour résumer cette fonction
religieuse du sacrifice humain, par leurs croyances
et leur conception du monde, les Aztèques se
trouvaient enfermés dans une spirale sanguinaire
sans fin destinée à préserver la
continuité du cosmos. Les sacrifices humains
chez les Aztèques avaient également un
rôle politique essentiel. Prêtres et guerriers
prédominaient dans la hiérarchie du pouvoir
politique aztèque. Ces deux groupes étaient
liés et interdépendants par le rite du
sacrifice humain. Les prêtres organisaient la
mise en scène sacrifielle, distribuant les rôles
et veillant à son bon déroulement jusqu'au
dernier acte : la mise à mort. Quant aux guerriers,
ils pourvoyaient les autels en sacrifiés avec
leurs captifs. Le pouvoir politique passait donc par
les sacrifices humains dont les autorités religieuses
et militaires se partageaient les responsabilités.
Par sa fonction terrifiante et intimidatrice auprès
du peuple et des étrangers - les crânes
des suppliciés étaient exposés
en permanence - les sacrifices humains légitimaient
et assuraient le maintien du pouvoir des dirigeants.
Ils justifiaient également l'expansionnisme aztèque
avec les guerres indispensables pour satisfaire une
demande insatiable en captifs. Christian Duverger dans
son approche structuraliste considère le sacrifice
humain comme la raison même de la puissance aztèque.
A l'instar de Jacques Soustelle qui définit le
rite sacrifiel comme : "une transmutation par laquelle
on fait de la vie avec de la mort", Duverger voit dans
cette mort sacralisée une façon de libérer
et de récupérer l'énergie vitale
contenue dans le corps humain afin de sustenter l'astre
solaire, dévoreur d'énergie. Cette vocation
énergétique, note Duverger, est sans issue
puisqu'elle condamne les Aztèques à une
expansion forcée et ruineuse pour se procurer
ces ressources énergétiques humaines dont
la pénurie prévisible peut provoquer une
déstabilisation de l'économie. L'archéologue
A. Demarest qui s'est intéressé à
l'ethnohistoire des Aztèques, considère
aussi le sacrifice humain comme une cause du développement
de l'empire aztèque et que toutes les transformations
politiques accomplies par les Aztèques reposaient
sur l'idéologie sacrifielle qui justifiait de
plus en plus la guerre ou la compétition entre
Etats.
|
|
|
|
| Sacrifiés
et sacrificateurs |
|
Quelles
étaient les victimes des sacrifices aztèques
? En premier lieu, ce sont les captifs ramenés
d'expéditions guerrières que les Aztèques
appelaient Xochiyaoyotl, "les guerres fleuries". La
raison principale de ces combats était la capture
de prisonniers afin de pourvoir les autels en sacrifiés.
Le chroniqueur Munos Camargo témoignera dans
ces textes de ces guerres de ravissement où la
vie est plus précieuse que la mort : "Ils attrapaient
et capturaient ceux qu'ils pouvaient et c'était
là leur principal butin et leur principale victoire
: faire de nombreux captifs pour les sacrifier à
leurs idoles... Car ils tenaient pour meilleur exploit
de capturer plutôt que de tuer." La deuxième
catégorie de victimes était les esclaves.
Les commerçants aztèques, les potchecas,
les achetaient pour les offrir en sacrifice.C'était
pour eux un moyen de participer au pouvoir dont le sacrifice
était la démonstration. Rappelons ici
que le sacrifice restait le monopole des castes dirigeantes.
La dernière catégorie de condamnés
était ceux qui avaient écopé du
fardeau de personnifier les dieux. Ces "images des dieux"
comme les appelait Sahagun, n'étaient pas de
simples figurants déguisés mais devenaient
eux-mêmes des divinités au milieu des hommes.
Ainsi c'était "l'image" de Uixtocihuatl, déesse
du sel, qui était immolée ou bien encore
celle de Xilolen, la vierge-mère, déesse
du jeune maïs. Ces individus, véritables
représentations humaines des dieux, étaient
choisis selon des critères très spécifiques.
Par exemple, les enfants que l'on sacrifiait aux dieux
de la pluie se devaient d'avoir deux tourbillons de
cheveux sur la tête et d'être nés
sous un bon signe. Qu'ils soient captifs, guerriers
ou "images des dieux", les sacrifiés étaient
la plupart du temps étrangers à la société
aztèque. On sacrifiait avant tout "l'autre".
Cette altérité qui nourrissait les dieux
et les hommes - nous aborderons dans un autre chapitre
l'anthropophagie postsacrifielle - assurait de conserver
intactes les forces vives de l'empire Aztèque
tout en affirmant son expansion.
Dans la société hiérarchisée
aztèque, bien que souverains, militaires et commerçants
puissent organiser des fêtes sacrifielles, seuls
les prêtres sont habilités à tenir
le rôle de sacrificateur. Chaque prêtre
portait comme titre le nom du dieu qu'il représentait
et lors des fêtes consacrées à sa
divinité, il était choisi pour accomplir
l'exécution des victimes. Par ailleurs, bien
que les femmes ne soient pas écartées
de la profession de prêtresse, le geste sacrifiel
ultime semble avoir été le monopole de
l'homme.
|
|
|
|
| Les
différentes étapes du sacrifice humain |
|
La
fête est la manifestation la plus frappante de
la violence et de la ferveur de la foi aztèque.
Elle est quasiment quotidienne et sert de cadre au sacrifice
humain qui en est sa finalité. La foule des dieux
du panthéon aztèque explique le rythme
vertigineux des périodes festives. La fête
aztèque est un véritable spectacle permanent,
monté et offert à la population par les
castes dirigeantes. Sahagun témoignera du faste
et de l'importance des agapes : "Le corps des esclaves
était peint de jaune et leur visage de vermeil.
Ils portaient un plumage en forme de papillon, fait
avec les plumes rouges des perroquets. Ils tenaient
dans leur main gauche un bouclier fait de plumes blanches,
avec les serres qui pendaient. Les prisonniers étaient
peints en blanc, ornés de guirlandes de papier,
coiffés de plumes blanches." Le marchand désireux
de donner une fête devait acheter "d'abord du
maïs, des haricots, des graines d'amarante, du
chile, du sel et des tomates, le tout en très
grande quantité. Il devait ensuite se procurer
les dindes, cent ou quatre-vingts, et les chiens, vingt
ou quarante. En plus, il devait s'approvisionner en
cacao, vingt charges ou plus, et acheter les écuelles,
les vases, les corbeilles et toutes les autres chose
nécessaires au repas."
Ces dépenses ruineuses pour ceux qui organisaient
les festivités étaient compensées,
nous l'avons vu, par le prestige social qui en découlait
et par le fait même de participer à la
gestion du pouvoir lié au sacrifice. La scène
où se jouait la mise en scène sacrifielle
se devait également d'être démesurée.
Des temples monolithiques furent spécialement
construits pour accueillir les acteurs et figurants
du sacrifice humain. Les actes du rite sacrifiel s'accomplissaient
toujours dans un ordre prédéterminé,
tout était soigneusement préparé,
rien n'était laissé au hasard. Quoi qu'en
disent les textes, qui souvent abordent le fait d'être
sacrifié comme une faveur, voire un titre honorifique,
les victimes ne devaient pas se présenter devant
leur bourreau, le sourire aux lèvres. Sinon un
sourire d'hébété provoqué
par les nuits blanches et les drogues de la préparation
présacrifielle. Cette préparation avait
pour but "d'anesthésier" la future victime en
l'amenant à un épuisement physique total
qui assurait aux prêtres le consentement halluciné
du supplicié au moment de la mise à mort,
et ainsi le bon déroulement du spectacle. Diverses
méthodes étaient employées pour
enlever toute énergie aux sacrifiés :
privation de sommeil, jeûne, danses interminables
et absorption de stupéfiants. "On les obligeait,
rapporte Sahagun, à veiller toute la nuit en
chantant et en dansant." Le prélude au sacrifice
prenait parfois une tournure érotique lorsque
la victime masculine se retrouvait entourée de
plusieurs femmes qui se devaient d'égaler les
déesses de l'amour. Le fameux jeu de balle mésoaméricain
et autres simulacres de combats correspondent également
à la dépense physique imposée par
le sacrifice. Suite à ces préliminaires,
dont l'objectif, rappelons-le, était de garantir
une apparente et relative sérénité
des sacrifiés, le moment fatidique arrivait et
"au milieu de la nuit, ils plaçaient les captifs
devant le feu et leur coupaient une mèche de
cheveux sur le sommet du crâne...C'étaient
les prêtres qui sacrifiaient les captifs. Ceux
qui les avaient fait prisonnier ne les tuaient pas eux-mêmes;
ils les apportaient à titre d'offrande; alors
les prêtres s'en saisissaient, les prenaient par
les cheveux et les conduisaient au sommet de la pyramide."
(Florentine Codex, partie 3)
Par ce geste symbolique du prélèvement
de la mèche de cheveux, le captif prenait le
statut officiel d'offrande communautaire. Son triste
sort en était jeté : "Les prêtres
déposaient le captif sur la pierre, lui ouvraient
la poitrine, lui fendaient la poitrine : alors ils coupaient
le coeur, ils cassaient les fils du coeur..." (ibid)
Le prêtre offrait alors à la divinité
du jour choisi, le coeur sanglant et encore palpitant
du captif, puis le déposait dans un récipient
cérémoniel. Pour ce type de sacrifice,
le plus répandu chez les Aztèques, le
scénario demeurait immuable : éventration
de la poitrine à l'aide d'un couteau de silex
puis ablation du coeur. On imagine aisément l'effroi
et la douleur de la victime quand la main du prêtre
plongeait dans ses entrailles pour en arracher le coeur.
Le nombre de sacrifiés variait selon l'importance
des festivités. Quarante à cinquante personnes
étaient nécessaires pour une fête
digne de ce nom. L'apogée sacrifielle aztèque
semble avoir atteint un summum dans la démesure
lors de l'inauguration du Grand Temple de Tenochtitlan
avec le chiffre, selon les textes, de 80 000 victimes
en quatre jours ! Ce nombre de sacrifiés paraît
improbable, voire impossible pour une ville de 200 000
habitants. Une estimation plus modérée
de 4000 victimes apparaît dans d'autres textes.
Mais ce chiffre, néanmoins, n'en reste t-il pas
surprenant?
Chez les Aztèques, le sacrifice par arrachement
du coeur a une valeur doublement symbolique. On trouve
dans leur iconographie, de nombreuses images évoquant
le soleil se nourrissant de coeurs humains. Quant au
sang qui ruisselle le long des marches de pierre, il
vient abreuver le dieu de la terre, qui elle même
nourrit les hommes. D'autres scénarios sacrifiels
aztèques existaient mais peu usités comme
la décapitation, la crémation ou l'exécution
par flèches. La mise à mort ne clôturait
pas pour autant le spectacle sacrifiel aztèque.
Suite au meurtre rituel, le cadavre de la victime pouvait
être décapité, écorché,
dépecé et consommé. La décapitation
postsacrifielle est attestée par les fameux Tzompantli,
structures de bois où se trouvaient empalés
et exposés aux yeux de tous, les nombreux crânes
des suppliciés. L'effet dissuasif était
garanti. Quant à l'écorchement, où
l'on revêtait la peau sanguinolente du sacrifié,
s'il était d'un usage plus restreint, il n'en
restait pas moins saisissant pour ceux qui y assistaient.
L'anthropophagie semble être le dernier acte du
sacrifice humain où les dignitaires - les gens
du peuple étaient exclus de cette pratique -
se partageaient le corps de la victime. Ce cannibalisme
postsacrifiel évoque la liturgie chrétienne,
comme dans la communion divine "chacun d'eux mangeait
un petit morceau du corps et l'on disait que c'était
le coeur du dieu Uitzilopochtli." (Sahagun)
|
|
|
|
| Les
conquérants espagnols et les sacrifices humains
|
|
Les
conquérants espagnols furent horrifiés
par les sacrifices humains aztèques, dans lesquels,
ils ne voyaient qu'une perversion démoniaque
et auxquels en tant que chrétiens, ils se devaient
d'y mettre fin. Le Conquistador Anonyme écrira
: "Il est tout à fait notoire que ces gens voyaient
le diable dans ces effigies qu'ils faisaient et qu'ils
tiennent pour leurs idoles et que le diable s'introduisait
à l'intérieur de ces idoles et de là
s'adressait à eux et leur commandait de faire
des sacrifices et de leur offrir des coeurs humains
parce qu'elles ne se nourrissaient pas d'autre chose..."
Les Espagnols ne pouvaient comprendre la pratique du
sacrifice humain dont l'inhumanité qu'elle représentait
pour leur esprit européen, justifiait en même
temps leurs pillages des richesses aztèques et
leur conquête sanglante et destructrice du monde
amérindien. Alors que le sang versé par
les Aztèques, coulait non pas pour la possession
de biens, mais pour le plaisir des dieux et que le sacrifice
humain était un acte profondément sacré
dont dépendait la continuité du cosmos.
|
|
|
|
| Le
silence amérindien |
|
Entre
1492 et 1550, le monde amérindien sera alors
englouti par la conquête espagnole. Quelques siècles
plus tard, en 1936, un poète européen,
Antonin Artaud, accostera dans le port de Vera Cruz
et viendra rompre ce silence pour "suivre son rêve
d'un retour à l'empire aztèque." (J. M.
G. Le Clézio)
Le poète désespéré prendra
la défense des cultures autochtones moribondes
en écrivant : "Je suis venu au Mexique chercher
une nouvelle idée de l'homme. Les dieux du Mexique
sont les dieux de la vie en proie à une perte
de force, à un vertige de la pensée. Oui,
je crois en une force qui dort dans la terre du Mexique.
C'est pour moi le seul lieu du monde où dorment
les forces naturelles qui peuvent être utiles
aux vivants. Je crois à la réalité
magique de ces forces, comme on peut croire au pouvoir
curatif et salutaire de certaines eaux thermales. Je
crois que les rites indiens sont les manifestations
directes de ces forces. Je ne veux les étudier
ni en tant qu'archéologue, ni en tant qu'artiste,
mais comme un sage, au vrai sens du mot; et j'essaierai
de me laisser pénétrer en toute conscience
de leurs vertus curatives, pour le bien de mon âme."
("Lettre Ouverte aux Gouverneurs de l'Etat", publiée
le 19 mai 1936, dans le Nacional )
|
|
J.L.B
|
|
|
|
|
|
|